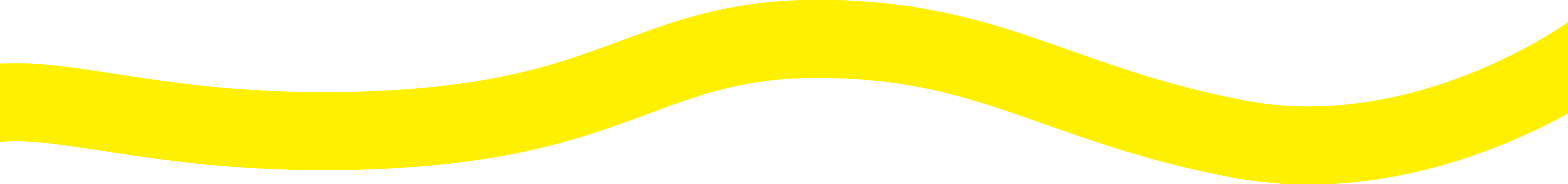Articles

Autodétermination et handicap : définition et liens
Chaque jour de notre vie, nous faisons des choix sans même nous en rendre compte. Mais, du fait de leur handicap, certaines personnes peuvent se retrouver limitées dans leurs prises de décision. Comment les aider à satisfaire leurs désirs et faire preuve de plus d'autonomie ? C'est ce que nous évoquons dans cet article sur l'autodétermination.
Vous avez peut-être déjà entendu parler d’autodétermination… mais n’avez jamais eu l’occasion ou la capacité de la travailler en cabinet ou établissement.
À moins que vous n’ayez déjà tenté, en tant que professionnel, d’appliquer ce concept, tout en rencontrant des freins qui vous semblent impossibles à surmonter ?
Avoir un projet de vie, choisir ses vêtements le matin ou son moyen de transport représentent autant d’actes auxquels nous ne pensons même plus tant ils nous semblent simples. Mais, pour les personnes en situation de handicap, prendre des décisions n’est pas toujours évident. Elles peuvent aussi, malgré leurs désirs, faire face à des déceptions à cause d’un manque d’aptitudes ou d’un environnement adapté.
Quelles sont les spécificités de l’autodétermination ?
Quels sont les liens entre autodétermination et handicap ?
Comment la mettre en place au sein de votre établissement médico-social ou foyer ?
Découvrez toutes nos réponses !
Qu’est-ce que l’autodétermination ? Définition
Chaque jour, nous décidons de nos propres actions que nous soyons enfant, adulte ou senior. Cela peut être de « petits » choix, comme la paire de chaussures à mettre aujourd’hui. Mais aussi des choix plus déterminants, comme les études à entreprendre.
C’est ce que nous appelons l’autodétermination : la capacité de faire ses propres choix et de devenir acteur ou actrice de sa propre vie.
Malheureusement, nos décisions dépendent de nos désirs… et ces désirs ne peuvent pas toujours être réalisés. Vous souhaitez partir en vacances avec des amis ? Ceux-ci peuvent très bien ne pas être d’accord.
Dans ces contextes, il nous est alors nécessaire de gérer le sentiment de frustration qui peut nous envahir : c’est l’autocontrôle.
Bien sûr, tout ceci n’est possible que dans un environnement adapté pour chaque individu… y compris les personnes en situation de handicap.
Pourquoi développer l’autodétermination des personnes en situation de handicap ?
1. Développer l’autonomie
Pour celles et ceux qui ont des besoins spécifiques, les gestes de tous les jours peuvent être compliqués à réaliser.
Dans ce cadre, nous avons tendance à faire des choix ou des actions à leur place. Mais ces gestes qui nous semblent alors aidants peuvent bloquer les personnes dans l’atteinte de leur autonomie.
Or, cette autonomie est fondamentale pour le développement personnel, mais aussi pour l’inclusion sociale. Une surprotection, au contraire, peut affecter sa confiance en soi.
Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner tout accompagnement ! Bien au contraire, gagner en autonomie est un processus progressif. Que ce soit des enfants qui n’ont aucun handicap ou une personne qui a des besoins particuliers, l’expérimentation, l’échec et l’apprentissage sont nécessaires au développement de l’autodétermination.
2. Favoriser le bien-être des personnes
Développer son autonomie permet par ailleurs de favoriser son bien-être. Comment ? Tout simplement en permettant à la personne de répondre directement à ses besoins, mais aussi à ses envies… et de pouvoir concrétiser au mieux son projet de vie.
3. Répondre à des enjeux sociétaux
Favoriser l’inclusion sociale est un enjeu primordial ! A travers l’autonomie et, plus largement, l’autodétermination, la personne accède à une certaine liberté. Celle de choisir par elle-même le travail qu’elle souhaite exercer par exemple.
Bref, elle accède à un statut social, essentiel dans nos sociétés.
Ceci lui permet d’accéder à la citoyenneté comme n’importe quelle personne.
4. Une recommandation de la HAS
Travailler l’autodétermination des personnes avec un trouble du développement intellectuel (TDI) est recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis juillet 2022.
Bref, plus question de rester les bras croisés !
Quelles sont les 4 composantes de l’autodétermination ?
1. L’autonomie comportementale
C’est la capacité à faire des choix de manière indépendante tout en assumant les conséquences.
2. L’autoréalisation
Pour aller vers l’autodétermination, il est nécessaire de connaître :
- ses désirs et préférences ;
- ses compétences personnelles ;
- ses limites ;
- mais aussi ses propres émotions.
Cette autoconscience (ou conscience de soi) n’est pas toujours aisée pour les personnes en situation de handicap… Pourtant, la développer permet aux individus de mieux déterminer leurs objectifs de vie.
3. L’autorégulation
Ce processus cognitif se résume par la capacité à réguler ses propres comportements et ses émotions. Pour y parvenir, les personnes doivent travailler :
- leurs fonctions exécutives (attention, planification, anticipation…) ;
- la gestion de leurs émotions.
Pour ne citer qu’elles, les personnes avec un déficit intellectuel ont tendance à présenter des troubles du comportement souvent liés à des frustrations. Car prendre des choix, c’est aussi se confronter à des déceptions.
Or, ceci peut générer une démotivation… Et donc avoir un impact sur le désir d’aller vers une autodétermination.
4. Le pouvoir d’agir
Contrôler ses propres actions est également une composante de l’autodétermination.
Dans le champ du handicap, cela signifie d’accompagner les personnes vers une plus grande autonomie.
Ceci leur permet de développer leurs capacités et talents pour, à terme, mieux gérer les situations de la vie quotidienne.
L’importance de l’entourage dans le soutien à l’autodétermination
Établissements et professionnels
Bien évidemment, les différents spécialistes du handicap jouent un rôle clé dans l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation de handicap.
Vos responsabilités ? Définir des objectifs réalistes, observer et réévaluer ces objectifs, fournir des aménagements adaptés, etc.
Par exemple, vous êtes en contact avec une patiente qui désire se laver de manière autonome ? Aménagez l’espace selon son handicap avec une douche PMR par exemple.
Comme dans tout travail d’accompagnement, collaborer avec une équipe pluridisciplinaire favorisera l’acquisition de l’autonomie. Éducateurs, psychologues, soignants : chaque intervenant a son rôle à jouer.
La famille
Le soutien familial est un point clé pour aller vers l’indépendance et la liberté de choix. Une coopération de qualité entre les accompagnants, les parents et la personne concernée devient alors fondamentale.
En effet, c’est au sein de la famille que la personne va développer l’automotivation et l’estime de soi nécessaires à son pouvoir d’agir (ou empowerment). La famille, elle aussi, doit fournir un environnement adapté au renforcement des habiletés, tout en assurant l’absence de toute contrainte externe.
Note : Les parents peuvent d’abord se montrer réticents à l’idée de laisser plus d’autonomie à leur enfant. Pourquoi ? Tout simplement par peur de conséquences éventuelles (fugue, perdre des objets, abîmer du matériel, etc.). En tant que pro, vous pouvez entamer un travail de réassurance pour favoriser la coopération.

Quelles sont les conditions nécessaires pour aller vers l’autodétermination ?
Un accompagnement sur-mesure et flexible
Le développement d’une personne passe par plusieurs étapes.
Par exemple, elle peut d’abord avoir du mal à lacer ses chaussures seule : il faudra alors lui apprendre les nœuds à faire.
Puis, au fur et à mesure, vous la laisserez de plus en plus autonome. Elle intégrera peu à peu cet apprentissage pour, à la fin, faire ses lacets sans aide extérieure.
Toutefois, il se peut qu’elle n’ait pas les capacités nécessaires pour ce geste. À cause par exemple d’une déficience en motricité fine (comme dans les handicaps moteurs).
Dans ce cas, vous pouvez lui donner des chaussures à scratch.
Car le tout n’est pas de la forcer vers un apprentissage qui lui est impossible (au risque d’altérer son estime de soi ou sa motivation). Au contraire, il s’agit de renforcer son autonomie avec un accompagnement sur-mesure et flexible.
Quelques outils pour un accompagnement efficace
Voici quelques éléments à intégrer dans l’accompagnement au sein des foyers d’accueil médicalisés et des établissements et services :
- la communication alternative et augmentée, avec des outils comme les tableaux de choix (pour renforcer son pouvoir décisionnel), des aides visuelles ou des pictogrammes (pour mieux communiquer entre patients et accompagnants) ;
- l’échelle de l’autodétermination pour évaluer les habiletés et les compétences, ainsi que les progrès réalisés (par exemple en termes de prise de pouvoir et d’affirmation de soi) ;
- les nouvelles technologies (par exemple, les GPS permettent de suivre à distance les progrès réalisés dans les déplacements autonomes) ;
- les différents outils permettant d’adapter l’environnement aux besoins de la personne (par exemple, un timer pour une meilleure gestion du temps ou un monte-escalier pour les personnes en fauteuil roulant).

Autodétermination et handicap : conclusion
Finalement, l’autodétermination passe par le gain en autonomie : prise de décision, communication, réalisation des gestes de la vie quotidienne…
Ce droit à l’autodétermination fait partie des besoins fondamentaux de chaque personne : d’où son importance. Elle permet de participer à la vie sociale, d’accéder à la citoyenneté et d’intégrer la vie professionnelle. Bref, de favoriser l’inclusion.
Mais comment, concrètement, favoriser l’autodétermination des personnes en situation de handicap ?
Comment les encourager à aller vers plus d’indépendance ?
Comment passer outre les freins et difficultés rencontrés ?
Notre journée dédiée à l’autodétermination a justement été pensée pour vous permettre de :
- mieux comprendre ce concept ;
- connaître les méthodes et outils pratiques ;
- définir des stratégies pour surmonter les difficultés rencontrées.
Transformez vos pratiques dès le 15 mai 2025 et participez à une société plus inclusive !